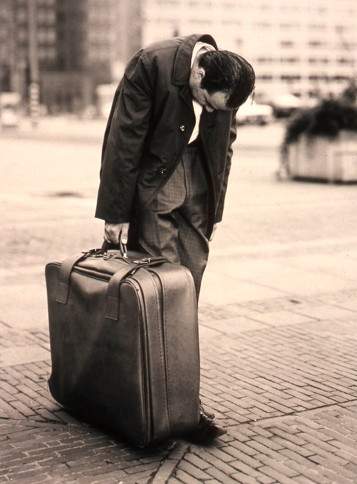Il n'y a donc pas que l'obscure clarté des étoiles à venir du lointain passé de la nuit des temps, la faible clarté, qui nous permet d'appréhender le réel, de voir, de comprendre notre environnement présent, provient elle-même d'une lointaine mémoire visuelle sans laquelle il n'y a pas d'acte du regard.
Paul Virilio
Les images seraient des choses instables, propres aux nombreux débordements et ayant tendance à disparaître rapidement. Les images, aujourd’hui, c'est comme si on ne pouvait plus les arrêter de défiler, qu'on ne pouvait plus les fixer ne serait-ce qu'un moment quelque part sur une cimaise, une page ou un écran . Elles tournent et virevoltent dans un mouvement ample, incessant, anarchique, pour aller finalement disparaître on ne sait où, aspirées par on ne sait quelle force obscure. Les images n'auraient d'autre existence que celle qui leur est conférée au moment même de leur apparition... Après, au-delà, elles ne seront plus que dépôt fugace et poussière insignifiante auquel plus personne ne prêtera attention.
La fin des choses
Pour les images, tout semble dorénavant fonctionner de plus en plus sur ce scénario de l'aléatoire et de la déraison. Faut-il se surprendre et s'étonner de tant de gaspillage, de tant de pertes. Non, pas vraiment, car cela va bien avec ce que nous claironnent sur tous les tons les promoteurs, idéologues et gérants du néocapitalisme. Cela va bien avec leur sacro-saint culte de ce qu'ils appellent le changement : ce culte qui à défaut de pouvoir nous dire quelque chose de sensé sur les motifs profonds qui agitent cette pensée du remplacement rapide des choses - quand ce n'est des êtres - n'a de cesse de nous rabattre les oreilles avec un discours creux sur le principe de l'inéluctable et les vertus de l'incertitude. Voilà sans doute ce qui les justifierait de croire qu'à peine une image vient-elle d'apparaître, il faut de suite en répudier la réalité et à en invoquer la fulgurante évanescence. Dans les domaines de la circulation rapide des objets et des signes, hauts lieux de ce culte du pseudo-changement, on parlera alors de vie fantôme et d'effet trompe-l'oeil, pensant du même coup qu'il s'agit là de la véritable nature des images. Il est vrai que des outils puissants venus d'une technologie du numérique, d’ores et déjà fort bien engagée dans le domaine de la production des images, prêtent leur concours de façon toute spéciale à ce vaste mouvement, en pleine expansion, de la circulation et de la mort rapide des images. Illusion d'une image sans épaisseur ni durée, illusion d'une image sans suite. Devant le mirage technologique, auquel plus rien ne semble résister, c'est la tourmente et la tempête qui fait rage : nous voilà à demeure dans l'oeil du cyclone. C'est comme un cap Horn qu'on n'arriverait plus à doubler, c'est comme des écueils sur lesquels viendraient se déchirer inlassablement les frêles coques de nos représentations. Les vents nous sont contraire. On ne sait plus dire ce qui se passe. Pourtant, on nous affirme que nous sommes entrés dans un âge de la rationalisation et de l'économie - au sens restreint du terme -, mais ce que l'on voit, ce que l'on entend de toute part ressemble bien davantage au règne de l'arbitraire et de la vindicte aveugle. Les images seraient à l'avenant : folie et précipitation, rien ne demeure si ce n’est le temps de sa consommation immédiate. Le zapping serait le seul geste qui tienne lieu de pensée dans un monde dont on voudrait qu’il ressemble le plus possible à un vaste vidéo clip sur fond de world beat et de salsa. Les images seraient comme des feuilles d'automne qui n'en finiraient pas de tomber et qui iraient s'accumulant en masses compactes, inertes, froides, mortes sur les bas-côtés des voies publiques de la pensée, de l'histoire. Plus rien de déchiffrable à leur surface. Fin des signes, ou du moins de leur apparence première, fin des alphabets, fin des réseaux serrés du sens : il n'y aurait que l'éphémère d'un brouillage immense des appareils - autant ceux qui reçoivent que ceux qui émettent. Fin des choses, des catégories, de la pensée, de l'histoire même; nous sommes entrés dans un âge de la perte - autant celle de la mémoire que celle de la conscience. Démesure.
Maquisards
Pourtant, en dépit du tumulte que font les images, en dépit de la folie et de la mort rapide qui rôde, ici et là se trouvent quelques poches de résistance où les bombes à fragmentation des technocrates apprentis sorciers de la technocratie n'ont pas tout rasé. Ici et là, il y aurait, en fait, une nouvelle conscience de l'image en voie d'émergence, un maquis riche et dense où s'exerce un autre regard, une autre vision. Dans ce maquis, et peut-être seulement là, il y aurait en fait une manière différente de concevoir l'existence des images et, en corollaire, une nouvelle façon d'en définir le mode d'action. L'exposition Configurations changeantes se veut, un peu et beaucoup à la fois, une incursion dans ce maquis en proposant le travail de quelques artistes qui auraient en commun de donner à voir cette nouvelle conscience de l'image.
En préparant cette exposition et en pensant à ce que devait en être le coeur, il apparaissait crucial de rendre d'abord perceptible le fait que l'image, telle qu'elle se trouve employée par les artistes de maintenant, se présente sous plusieurs aspects et dans divers états. À voir ces diverses manifestations de l'image, et au-delà de l'évidence d'un polymorphisme des formes et des genres, il semble que d'anciennes orthodoxies se seraient évanouies au profit d'une sorte de syncrétisme des divers états et aspects. S'il est une nouvelle conscience de l'image, celle-ci se doit de passer inévitablement par la reconnaissance de ce phénomène. Là où hier, il y avait compartimentation et division, domine maintenant une sorte de collusion des règnes où ce qui importe serait moins le fait du comment et du quoi des images, que la mesure de leur pourquoi et la considération de leur destination. De ce point de vue, on pourrait croire que l'on est très près d'un moment où l'on pourra parler des images sans avoir à faire intervenir d'interminables discussions sur les idiosyncrasies des médiums et des techniques utilisées pour les produire. On sait, à cet égard, l'hégémonisme de la photographie, encore présent il y a peu, et la main mise de ce médium sur le concept d'image. La confusion était telle, qu'il y eut pendant longtemps un usage indistinct des termes « image » et « photographie ». L'usage qui se généralise présentement de l'appellation "image photographique" permet d'entrevoir - à tout le moins partiellement - une nette transformation du langage, témoignant en quelque sorte d'une pensée de l’image qui irait en se complexifiant.. Il semble en effet que l'on soit plus près maintenant de percevoir ce qui est véritablement en cause dans la question de l'image et des moyens de sa genèse. Toutefois, et il s'agit là d'un incontournable paradoxe, il nous faut mettre cette évolution du langage – mais, en fait, surtout de la pensée - en très grande partie sur le compte d'un certain nombre de développements technologiques. Le"traitement" de l'image par ordinateur nous a en effet obligés - au début, indirectement - à poser la question de l'image en des termes plus larges que ceux qui prévalaient jusque-là. En tant qu'images à part entière, les produits iconiques issus des manipulations informatiques nous ont forcés à revoir nos catégories premières et à questionner notre conception générale de l'image en adaptant celle-ci aux nouvelles réalités introduites par le numérique. On remarquera que cette réévaluation avait déjà été en partie amorcée avec la venue de la vidéo, qui, selon Raymond Bellour devait donner naissance à une nouvelle catégorie d'images dites électroniques. Le numérique et les ordinateurs vont cependant montrer avec peut-être encore davantage d'éclat le caractère éminemment polymorphe des images et démontrer hors de tout doute leur nature profondément « transformative ». On pourrait peut-être alors faire l'hypothèse que, d'un point de vue ontologique, l'image est une chose que la matérialité n'épuise jamais et cela peu importe qu’elle soit photographique, filmique, électronique ou numérique. L'image est finalement quelque chose qui se manifesterait au-delà des supports et des formes. L'image est en ce sens affaire d'immatérialité et ne pourrait jamais figée dans une forme particulière. Dotée de toutes les singularités, et telle une pellicule qui serait sans substance, elle peut, au gré des usages et des offices, prendre toutes les formes, tous les états. La nouvelle conscience des images serait alors ceci : la reconnaissance que devant l'image on est devant autre chose que les seuls moyens qui ont été mis en oeuvre pour en générer l'existence. Devant l'image, on est, en définitive, au-delà des éléments qui la composent et qui lui donnent forme. Devant l'image, on est, d'abord et avant tout, devant une sorte de fantôme paradigmatique. Une étrange enveloppe qui prend tous les contours de son environnement mais qui n'en retient jamais aucun de manière exclusive et mimétique.
Tel un fantôme
Au bout du compte, l'image ne serait qu'une suite ininterrompue d'états et de formes se développant tel une sorte de long continuum. Sur celui-ci se déploieraient différentes modalités d'existence de l'image, tout autant que différents états et matériaux qui lui donneraient formes et substance. D'une certaine façon, l'exposition Configurations changeantes pourrait être comme une sorte de parcours de ce continuum dans la mesure où les travaux des artistes de l'exposition s'y retrouveraient en divers points et niveaux. On fera ici ce parcours de l'exposition en y remarquant le travail de chacun des artistes et en y observant celui-ci autant en rapport au continuum image, qu'en fonction de sa problématique interne. Car - et c'est peut-être là la chose la plus importante - derrière la surface de l'images s'agitent des présences - on dira aussi des intentions -, et derrière celles-ci des auteurs. L'image n'est jamais en ce sens une chose en soi, elle n'est jamais une ultime finalité ; ou, plutôt, lorsqu'elle l'est, elle rejoint ces images qu'on évoquait tout à l'heure : des choses mortes par avance, des choses bêtes et dépourvues de sens.
L'artiste catalan Joan Fontcuberta, bien connu pour ces travaux sur le faux et la fonction mimétique de la photographie, présente ici une oeuvre installative où se trouvent combiner plusieurs types d'images. Mêlant dans un même geste et dans un même souffle la réalité et la fiction, Fontcuberta aime brouiller les pistes et surtout inventer de vastes trompe-l'oeil où viennent mourir nos derniers doutes quant à la vérité des choses. L'artiste sait nous entraîner sur des pistes où le sens est en déroute. Ici, il est moins question de fiction que de rapports en différé entre plusieurs pans de réalité, que de mise en abîme de l'image par la présence de traces d'une action réelle - un combat de coq - ayant eu lieu dans une arène constituée par une large feuille de papier photographique. Le papier garde la trace physique de ce combat, mais n'en garde cependant aucune représentation. Sur une boucle vidéo : le combat de coq tel que celui-ci s'est déroulé. Pourtant la réalité est ailleurs, car ce combat c'est une métaphore qui nous est révélée par cette autre composante de l'installation : un texte qui raconte Sarajevo sous les bombes vu du haut des airs. Le texte dit une image de nuages au-dessus de cette cité dévastée par la guerre civile, une image que l'artiste aura prise alors qu'il survolait cette ville à bord d'un avion de ligne. Un texte, des images, une confrontation entre le réel et la réalité, entre l'ici et l'ailleurs.
Le travail de Sophie Bellisent s'inscrit tout entier du côté d'une image portée de toute pièce par la technologie du numérique. Images de l'hybride qui seraient à quelque part entre la fixité et le mouvement, entre l'existant et l'inventé. Dans Wilt on, un travail précédent de l'artiste, il y avait le reflet du métal, le reflet de la douleur, le reflet du coeur meurtri. Il y avait aussi une sorte de regard qu'on aurait dit désarticulé, comme pourrait être de celui d'un ange : mais d'un ange déchu, perdu ; c'est sans doute pourquoi les images avaient cette couleur de métal. Les travaux actuels veulent aller plus loin. Bellissent ajoute d'autres couches, d'autres strates : des sons, l'ordinateur, le mouvement. Le métal est là toujours, mais cette fois il y est plus palpable, plus directement perceptible. Le prétexte du travail de l'artiste, qu'on définira comme étant multimédia au sens informatique du terme, est une situation qui tient lieu du polar. Le métal rencontre une autre sorte de métal. Il y a un immense et très palpable déchirement. Le son est aussi dirait-on plus image que l'image elle-même. Le glissement du regard, l'oreille qui vaque, l'image en l'absence d'elle-même, d'autres états de l'âme et toujours la douleur. Ici se trouve sollicitée puis dépassée une certaine esthétique de l'image et de son excès, de sa luxuriance dans les formes actuelles du clip vidéo mises à distance et puis brutalement décalées.
Des souvenirs qu'on dirait troubles, une sorte de mauvais film, les effluves d'une cuite qui aurait mal tournée. Il y a comme l'ombre portée de Charles Bukowski dans les travaux de Carol Dallaire, un artiste qui vit et travaille à Chicoutimi au Québec. Une poésie de la déroute tranquille. Dallaire use d'images inventées, de ces images dites de synthèse issues des manipulations d'un ordinateur muni de logiciels de traitement d'images. Mais l'artiste est aussi écrivain et il amalgame images et textes dans des combinatoires où par une sorte d'effet de renvoi, se crée une tension qui n'est pas sans rappelé le dispositif filmique. Couleurs de chaos dans des petits carrés bien trop sages : on recule imperceptiblement, on pense à la nuit, au brouillard froid et humide qui descend. L'artiste joue de l'ordinateur comme d'une machine à dessin qui permettrait une sorte de tridimensionalité qui fonctionnerait dans l'aplat. Pour peu que l'on se prête au jeu, on pourrait se croire capable d'entrer dans l'image et de voyager dans l'épaisseur de celle-ci. Ce serait comme avancer dans un lieu fait de pièces en enfilades en soulevant des voiles diaphanes, une voix off nous accompagnant dans cette excursion impossible. Mais c'est là qu'une illusion, un costume de l'image. Dans le travail de Dallaire, il n'y a pas de politique ni de sentiments, seulement une espèce de regard décoloré, opaque, sombre, une réflexion en quinconce sur l'existence.
Les images ont plusieurs vies. Caroll Moppett a construit pratiquement l'ensemble de son oeuvre sur cette prémisse. Images trouvées, images empruntées, images qui deviennent autres : comme si on les dépliait et que, ce faisant, on découvrait une autre couche. Cette artiste de Calgary, dont la trajectoire est déjà impressionnante, fait depuis longtemps un travail qui concerne la politique et en particulier par celle de la représentation. D'oeuvre en oeuvre, l'artiste questionne notre rapport à la nature : en fait, elle pose un regard froid sur une certaine représentation de ce rapport dont le moins qu'on puisse dire est qu’il est d’une complaisance sans nom. Animaux sauvages "pris" aux filets de nos catégories trop étroites, trop exclusives. L'artiste compose une sorte de portrait de nous-mêmes en flagrant délit d'amnésie générale. Moppett s'occupe maintenant du paysage, et questionne à travers lui nos manières de le voir, de nous le représenter et surtout nos façons de nous l'approprier. L'artiste utilise et recycle ici les images d'un scientifique en quête d'informations sur des formations géologiques propres à receler du minerai exploitable. Devant nous, autour de nous, et de manière extrêmement dépouillée, des photos dites scientifiques, des notes techniques pour décrire des phénomènes d’ordre naturel : pourtant, ce qu'on y voit, pour nous, néophytes ce sont des paysages grandioses. La perception est prise au dépourvu. Il faut alors tout revoir ,mais sans les repères habituels. L'image, une image qui fait appel à autre chose qu'elle-même. Une image du second, voire du troisième degré.
Les objets à l'origine des oeuvres de Dominique Pelletey ne se donnent pas d'emblée pour ce qu'ils sont. Ces objets ont perdu, à force de mise en scène, leur réalité première. Ils sont devenus autre chose, des objets qu'on pourrait dire presque célestes, ou mieux encore, des objets d'une obscure cosmologie. De très grandes photographies appuyées contre un mur : les dimensions de l'image suggèrent très fortement un rapport au corps. Le travail de Pelletey se situe à quelque part entre la picturalité et l'iconicité, entre le tableau et l'image, dans ce que celle-ci peut avoir de plus têtue, de plus obtuse. De la photographie, certes, mais de la photographie qui n'a plus rien à voir avec le désir de dire le temps, de dire l'émotion. Ici, exit l'affect et le spectre de Roland Barthes, celui qui pourtant était venu le premier problématiser l'image photographique, en révéler les multiples couches et dimensions. Pelletey est à cent lieux de cela. Réduction des champs, réduction des plans. Image inventée, mais qui ne semble pas l'être. Image qui réfléchit, mais qui n'est pas pour autant un miroir. Pratique de l'éclat et du fragment et en même temps de la totalité, le travail de cet artiste est un travail sur le paradoxal, la limite des conditions de la représentation et plus loin de la signification. Le propos est au-delà de l'image, il est aussi en deçà de celle-ci. Serait-ce la postmodernité qui profile son ombre ici sur l'oeuvre en tant que système de sens et qui viendrait nous dire: "Il n'y a plus de sens qui puisse se donner de façon immédiate, gratuite et dans la plus totale naïveté. Il n'y a que des réseaux serrés à arpenter encore et encore."
En combinant et en amalgamant des images de voyage et des images de l'univers domestique, Ramona Ramlochand crée des espaces aux contours improbables, des lieux imprécis qui nous font hésiter sur le sens qu'il faut prêter aux images qui résultent. Mémoires, émotions et sentiments divers s'agitent dans des boîtes lumineuses qui irradient une curieuse lumière au milieu de la pénombre. Évocations d'un ailleurs dans une sorte d'ici vague, luxuriance de la couleur qui s'agite sur les surfaces translucides. L'artiste avoue être préoccupée par nos perceptions de l'espace, plus encore elle s'avoue préoccupée par la valeur subjective de ces perceptions. Les images deviennent ambidextres : d'un côté elles font toujours semblant de montrer, de l'autre ellent le nient catégoriquement en se présentant comme des manipulations avouées. La stratégie est ici installative au sens où l'espace est tout entier présent au sein même de l'oeuvre. Une image immergée dans l'eau renvoie son reflet magnifié, distorsionné dans l'espace en faisant surgir une nouvelle image. Une image qui tient davantage du fantôme que de tout autre chose, une image qui fait retour. Encore ici, il y a mise en scène de l'espace, encore ici il y a travestissement de la réalité, l'image le clame haut et fort, ne créant aucune confusion autour de ce qui constitue le spectacle des images.
Marc Audette utilise aussi l'ordinateur pour construire ses images. Mais l'utilisation qu'il en fait ne se révèle pas d'emblée. C'est que le traitement est est habituellement presqu’imperceptible, pour ne pas dire invisible, le résultant ayant tous les signes de la photographie. Ici la manipulation se fait plus large, sans être toutefois tonitruante. Il y avait eu le cycle des psychopompes, ces créatures de Duchamp que Audette avait fait revivre sur de grands cibachromes aux couleurs incertaines. Des êtres encore dans leur chrysalide, grands papillons en devenir ou bien encore personnages chevauchant d'improbables montures. Manipulations subtile s: le jour qui ressemble à la nuit, la nuit qui ressemble au jour. Un univers qui tourne au gré des déchirements intérieurs. Il y a le trouble, il reste une certaine angoisse. L'oeuvre de Audette emprunte les traits d'un voyage aux confins du sens : il continue cela ici dans de nouveaux travaux tout aussi incantatoires. Les mythes de Eko et Narcisse sont interpellés et puis croisés : le reflet de l'un nous renvoyant l'image de l'autre. Des visages qui de dédoublent les uns dans les autres. Une stratégie qui appelle une mise en espace de l'image. C'est que celle-ci n'est comme jamais donnée pour ce qu'elle est. Pas de mimétisme, pas de volonté de faire vraie. Ce qui reste est un lieu qu'il nous faut habiter pour un temps, un air dont il faut se laisser imprégner, un air de nulle part et qui charrie les effluves de quelque chose qui a déjà été là mais qui n'est plus. L'artiste parle de l'âme.
Céline Messier use de l'image photographique mais pas uniquement de cela. Ce qu'elle propose est installatif, elle joue sur la présence de l'objet autant que sur celle de l'image. Cela a à voir avec le temps parfois ; plus souvent cela provient d'un réseau serré d'effets de sens. On ne sait où cela mène, on ne sait où cela va. Les oeuvres se font parfois cinétiques : les choses bougent d'un mouvement imprévisible, ailleurs cela est d'une fixité inquiétante. La quête n'est pas ici une quête de l'image ou de la surface des choses : ce serait plutôt celle de l'entre-deux, celle du glissement, celle du brouillage entre les règnes et les ordres. L'image, dans sa facture, rappelle une certaine tradition du faire que vient nier un dispositif qui appelle, lui, l'éclatement, le déchirement et la mise à distance. L'échelle des oeuvres pointe le réel mais comme pour questionner celui-ci et lui faire subir un important détournement. Regard de l'inquiétude et de l'absence qui fait jouer au corps un étrange rôle. Le processus évoque celui de l'écriture mais d'une écriture qui serait faite sans les mots. Une écriture qui n'aurait gardé de la stratégie narrative que les volontés d'aller plus avant pour porter le verbe au-delà. On pense à la poésie et ses rythmes, ses écarts, ses ruses.
Les dispositifs de Daniel Canogar sont comme des pieds de nez à la technologie. Des projections dans l'espace de corps, de membres, issues de petites boîtes presque fondues au mur qui les porte – en fait, un dispositif en fait d'une désarmante simplicité -, des images immatérielles qui nous renvoient à une certaine idée de la fragilité, de la précarité des choses. Des choses en apparences trop simples s'il n'y avait pas cet aspect fantomatique qui nimbe ce qui nous est montré. Zones de lumière pâle, zones de lumière qu'on dirait sur le point de vouloir s'évanouir, de vouloir disparaître pour peu que l'on s'y attarde trop longtemps. Le propos de Daniel Canogar est comme une sorte de cri muet, de cri sourd contre l'absence, contre la perte de mémoire, contre les effets pervers de l'oubli. Juste cette présence trouble de la lumière. Quelque chose de très faible et qui pourtant prend toute la place. Le travail de cet artiste avec ses images spectrales nous force à poser la question de ce qu'est une image, minimalement. L'artiste ne nous souffle aucune réponse, il ne fait que nous tendre une main, un bras, pour tenter un rapprochement, quelque chose qui ressemble à un murmure fait de particules lumineuse.
Le legs
L'image est devenue une chose dont l'existence est on ne peut plus étrange - pour ne pas dire paradoxale -, et, ce qui n'est pas pour simplifier les choses, notre rapport à celle-ci est devenu de plus en plus ambigu. Encore plus étrange est le fait de constater que cet état intervient au moment même où notre connaissance des images se fait de plus en plus précise et que nous commençons à savoir beaucoup mieux ce qui s'y passe. Or, alors même que se constitue tout ce savoir de et sur l'image, notre foi en celle-ci s'est émoussée. Nous vivons avec les images depuis si longtemps que nous en sommes venus presque à oublier qu'elles existent. Nous avons développé à leur égard une sorte d'accoutumance et on dirait bien que nous ne les voyons plus. Ou plutôt que nous les voyons toujours mais que nous ne faisons plus attention à elle. Elle serait - au mieux - présence et accommodement du regard, sorte de bruit blanc des yeux. Il aura fallu cela, il aura fallu expérimenter cet état limite pour que puisse survenir autre chose, pour qu'apparaissent les premiers signes d'un autre temps, d'un autre état de notre perception des images.
Il y aurait donc cette idée que l'image est un continuum que nul médium ne peut aujourd'hui prétendre épuiser. Peut-être que cela ferait-il alors du sens que de penser les images comme une nouvelle classe d'objets, un nouveau lieu du savoir, un nouveau carrefour de l'être. Une conscience de cela, une conscience nouvelle qui est à voir le jour et que les artistes du visuel seraient occupés à rendre perceptible. Les artistes de cette exposition sont de ceux-là et ont tous en commun de porter l'image ailleurs dans le territoire de la conscience. Mais, aucun d'eux ne le fait comme s'il s'agissait d'un discours ou d'une théorie, car il s'agit ici d'images en action, d'images en procès. Les artistes de cette exposition, chacun à sa manière, chacun à propos de quelque chose de singulier, jouent ici des images comme s'il s'agissait de configurations changeantes, indiquant ultimement un autre paysage, un autre état du regard, un autre avatar de la pensée.
Dans son film intitulé Jusqu'au bout du monde, Wim Wenders imagine deux machines de vision: la première machine redonnerait la vue à ceux qui l'auraient perdue ; la seconde permettrait de fixer l'image des rêves d'une personne pendant son sommeil. Dans les deux cas, le cinéaste nous donnait à voir ce que les machines permettaient de voir et dans les deux cas ce que l'on voyait était des images approximatives. L'une nous faisait voir une scène comme s'il s'agissait d'un tableau reconstitué du peintre Vermeer, l'autre une sorte d'image de synthèse aux luxuriantes couleurs parcourues de formes indéfinies. Le cinéaste imagine par le biais d'une autre machine de vision - le film cinématographique - d'autres machines de vision, d'autres images. Mais les images qu'il imagine n'ont plus les qualités de netteté et de définition des images d'avant. Ces nouvelles images, dans leurs aspects rudimentaires, incomplets et parcellaires sont alors comme l'aveu que l'important, dans l'image, n'est ni sa vraisemblance, ni son aura de réalité. L'image, celle qui vient, celle à venir, serait en définitive toujours incomplète dans son apparence, mais par ailleurs totale comme acte de conscience et acte de pensée. L'image n'est plus une chose du réel, elle est un paradigme, mais un paradigme qui bouge, un paradigme en constant changement.